janvier 2024

Carte blanche sur le foncier
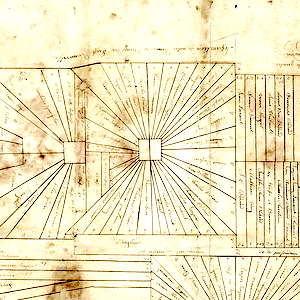
Regards croisés sur le foncier
Regards croisés sur le foncier,
Riurba no
15, janvier 2024.
URL : https://www.riurba.review/article/15-foncier/editorial-15/
Article publié le 10 fév. 2025
post->ID de l’article : 5452 • Sous-titre[0] :
Depuis son premier numéro, la Revue internationale d’urbanisme s’est engagée dans les débats contemporains du champ de l’aménagement et de l’urbanisme. L’ambition affirmée alors était de contribuer à l’organisation et à la diffusion des débats, non seulement dans le milieu académique, mais aussi avec les professionnels et les politiques. Nous affirmions de la sorte notre conviction que le champ de l’aménagement et de l’urbanisme ne saurait constituer une discipline « hors-sol », détachée des réalités concrètes du vécu des acteurs, des transformations vécues des territoires, des effets des politiques publiques et des intérêts privés : l’urbanisme étudié comme action, comme pratique à observer dans son rapport international, comme enseignement sur et pour nos pratiques, tels étaient les sujets d’inspiration inscrits dans le premier éditorial.
Alors que la Revue internationale d’urbanisme entre dans sa dixième année d’existence, quel autre sujet pouvait trouver plus forte actualité que le foncier ? En France, bien sûr, mais dans bien d’autres pays, cette ressource est rare, précieuse par les surfaces qu’il promet aux rêves d’aménagement et par les écosystèmes qu’elle protège sous sa surface, fragile enfin par les conséquences des pollutions et d’une transformation irraisonnée. Retrouver le sol sous le foncier, faire un état des connaissances et des débats contemporains, telles étaient les motivations de notre rédaction au moment de lancer ce nouveau numéro. Parce qu’il nous semblait éminemment particulier, nous avons décidé non pas d’organiser un appel à contributions comme nous le proposons habituellement mais de donner une carte blanche à des auteurs invités qui ont tous répondu. Nous restons cependant une revue scientifique, et tous les textes publiés ont respecté la procédure d’évaluation et de correction habituelle.
Cette carte blanche sur le foncier est donc riche de sept contributions.
Comme nous l’attendions, la ZAN (zéro artificialisation nette) occupe une place particulière dans les contributions. Alors que le sujet enflamme l’actualité et continue de mobiliser l’ensemble des élus en France, plusieurs textes éclairent le sujet et nous permettent sans doute de mieux poser les enjeux. Hélène Nessi explore ainsi ses impacts sur les pratiques des aménageurs et sur la production de logements ; Jérôme Dubois se préoccupe des tensions politiques et économiques que cette réforme induit, tout en expliquant combien les oppositions dépassent sans doute les effets réellement attendus : si l’objectif environnemental est clair, la mise en œuvre se révèle délicate, et les arbitrages sont difficiles à poser : comment concilier développement économique, attractivité résidentielle, préservation des sols ? C’est aussi la question que pose Gilles Crague en examinant la gouvernance foncière dans les villes industrielles. L’impératif de réindustrialisation conduit à inventer de nouveaux modèles pour l’action foncière, qui apportent plus d’anticipation, de flexibilité et de rapidité.
Sans doute plus que d’autres sujets de l’aménagement, le foncier met la régulation de l’action publique au défi de la justice sociale. Jean-Marie Halleux et ses coauteurs proposent une analyse approfondie des principes de maîtrise collective des rentes foncières à partir d’observations en Europe. Cette publication est le résultat d’un programme de recherche qui a réuni une centaine de chercheurs. Alors que les États et les collectivités locales peinent à financer infrastructures et services, l’appropriation des plus-values foncières par des acteurs privés réduit les capacités d’intervention, de régulation, mais aussi plus simplement de distribution et d’équité spatiales. Faut-il revoir les outils fiscaux et réglementaires pour mieux capter ces plus-values ? On retrouve ce débat dans l’article proposé par Mathilde Pedro, Juliette Maulat, Inès Delépine et Alex Lord. Les quatre auteurs y comparent les dispositifs de captation des plus-values foncières dans trois pays voisins : France, Angleterre et Pays-Bas. Ils en déduisent qu’au-delà des contrastes que présentent les exemples, la question des plus-values n’est pas qu’une simple question d’ingénierie financière, mais bien une modalité essentielle des transformations sociales et matérielles des territoires.
La gestion durable des sols est illustrée dans l’article de Youssef Diab qui présente la perception des terres excavées, davantage considérées comme des déchets plutôt que de constituer des ressources à valoriser dans les projets de construction et d’aménagement. C’est pourquoi l’article plaide pour l’organisation d’une véritable économie circulaire qui puisse satisfaire une gestion intégrée de toutes les ressources urbaines.
Enfin, dans un entretien accordé à la Revue internationale d’urbanisme, Franck Boutté, Grand Prix de l’urbanisme en 2022, insiste sur la nécessité de repenser notre relation au foncier, au sol, mais aussi, plus largement, aux continuités et discontinuités qui organisent notre espace. Les exemples qu’il mobilise sont autant de situations concrètes mais aussi de perspectives de réflexion, tant pour les chercheurs que pour les praticiens. Les contributions de ce numéro dessinent les contours d’un urbanisme en mutation, qui oscille continument entre régulation publique et dynamiques marchandes, entre exigences écologiques et actions de développement économique. À partir d’une réflexion sur le foncier, ce sont bien toutes les mobilisations et occupations du sol, de l’extraction des ressources naturelles à l’habitat, le commerce ou l’industrie, qui sont questionnées et qui doivent être révisées, dès lors que nous dressons un constat : celui de la finitude et de la rareté du sol que nous pouvons occuper.


